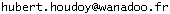| Réseau d'Activités à Distancerad2000.free.fr |
Vous lisez
http://rad2000.free.fr/mcrozier.htm
L’entreprise à l’écoute
![]() Racine
Racine
Ce document appartient au Cycle des Apprentissages Individuels et
Organisationnels.
![]() Plan
Plan
Introduction
1. Nouveaux principes
d’organisation
2. La tentation du discours
Conclusion
![]() Introduction
Introduction
Dans
“L’entreprise à l’écoute”, le sociologue
Michel Crozier tentait, dès 1989, de montrer comment certaines
entreprises s’efforcent “d’apprendre le
management post-industriel”. Nous n’insisterons pas sur le terme
post-industriel. La société industrielle
n’est pas sans agriculture. Elle n’est pas post-agricole. La
société d’information ne sera pas sans
industrie, ni post-industrielle. Elle sera un complexe d’agriculture,
d’industrie et de services. La facette industrielle des
réseaux socio-techniques sera l’automatisation
de tout ce qui peut l’être. D’où une pression
à l’élaboration de nouvelles
connaissances. Des connaissances toujours plus personnalisées
à leur identité dynamique pour les
nomades modernes que seront beaucoup d’entre nous. Des
connaissances toujours plus appliquées par les
contraintes d’une
instrumentalité redoublée. En bref, nous sommes
d’accord quand Crozier écrit: <<Le rôle
décisif dans la croissance économique est joué de plus en
plus par la haute technologie et les services. La haute technologie ne
crée pas elle-même beaucoup d’emplois, mais elle constitue
la source d’innovation principale dans l’économie et dans
la société (p. 25)>>. Ajoutons seulement, pour ne plus y
revenir, que l’utilisateur louera des services, tandis que
l’agriculture et les services utiliseront des produits industriels. Ces
produits industriels seront artificiellement intelligents et communicants. Ce
point est crucial.
Les produits en
réseaux deviennent une première source des besoins. Ces
besoins ne se lisent pas dans une anthropologie
fonctionnaliste à la Malinowski ou à la Maslow. C’est le
système des objets techniques qui fait que: <<la notion de
besoin perd sa signification. Planifier l’avenir ou
même simplement élaborer une stratégie à partir
d’une évaluation a priori des besoins à satisfaire
n’apparaît plus possible ni utile (p. 25)>>. C’est
pourquoi: <<L’accélération du changement dans un tel
monde de concurrence met en péril la stabilité des grandes entreprises et la
permanence des grands intérêts traditionnels. La lutte n’a
plus pour objet d’acquérir des rentes de
situation durables, mais de s’assurer une capacité
d’innovation et de renouvellement suffisante (p. 26)>>. Nous
sommes à un tournant, puisque nous passons de besoins planifiables
à des besoins interactifs. Les objets et les logiciels communicants
génèrent une spirale de besoins, pour eux, entre eux. Essayez
d’acheter un ordinateur pour votre travail et de dire: <<je
n’achète plus de logiciels pendant un an!”. Cette spirale
est bien supérieure à la spirale des besoins primaires des
humains. <<La logique dominante de la société industrielle
était fondée sur le couple production de masse-consommation de
masse. La production de masse permet d’abaisser les coûts et de
satisfaire de plus en plus largement les besoins, tels que la civilisation
occidentale les a définis (p. 27)>>. Ce point ne
disparaîtra pas, pour les objets. Mais leur
obsolescence obligera à une innovation
systématique. Accompagnée d’une plus grande
spécialisation, l’exploration du champ des
possibles aura pour but de saturer ce champ tout en
découvrant sa fractalité car tous les points ne
sont pas atteignables par tous les moyens.
Dans la
société industrielle de demain, les objets
génèrent une première spirale de besoins
matériels. Mais, sur ces multiples réseaux d’automates,
(transport automatisé, objets reliés au téléphone,
services délivrés quel que soit le lieu du travailleur ou de
l’usager nomade), les humains génèrent une seconde spirale
de besoins. Besoins d’informations à recevoir/émettre.
Besoins de connaissances à produire/formaliser/assimiler. Et
c’est là que le présent système touche ses
limites internes . Car, <<la faiblesse conceptuelle du
système et de la politique qu’il engendre, c’est
l’incapacité dans laquelle il se trouve de comprendre vraiment
l’homme comme acteur libre et autonome (et finalement
comme facteur essentiel de la production) et de dépasser une vision
quantitative de la demande (p. 28)>>. C’est pourquoi: <<La
logique nouvelle que l’on voit émerger et remplacer
insensiblement cette logique, est fondée sur des priorités tout
à fait différentes. Elle est symbolisée par la
prédominance du couple hautes technologies-services sur le couple
consommation de masse-production de masse (p. 29)>>. La
conception et la qualité font de la ressource humaine
et de ses connaissances un élément central. D’où
l’importance de l’apprentissage
individuel.
Surtout, il faut construire un
apprentissage organisationnel. Loin des pratiques décisionnelles
magiques, l’apprentissage organisationnel favorisera et capitalisera l’apprentissage
individuel. Alors, <<ce qui est en jeu, ce ne sont plus seulement les
techniques et les méthodes, mais une autre théorie du
comportement humain et une nouvelle conception de l’
action collective (p. 33)>>. Au lieu d’une
organisation intégriste, lit de Procuste qui force les
individus à rentrer dans la norme , il faut une
organisation stimulante, qui cultive la variété
des produits et des compétences. <<Le paradoxe moderne,
c’est que plus les individus sont libres, plus une anarchie humainement
acceptable ne reste possible qu’avec un supplément extraordinaire
d’organisation (p. 40)>>. Mais, cela va de soi, selon de nouveaux
principes.
![]() 1. Nouveaux principes
d’organisation
1. Nouveaux principes
d’organisation
Les nouveaux principes sont en
rupture avec le passé. <<La perte de sens et le désarroi,
voire parfois la panique, que les ruptures logiques suscitent sont, on
l’oublie trop souvent, des freins plus efficaces au changement que les
intérêts matériels et même que les attitudes
routinières que l’on a coutume de décrire dans les
analyses de la résistance au changement. C’est seulement
l’incarnation de la nouvelle logique dans les modèles
d’organisation qui va donner le sens sans lequel ne
peut se développer un apprentissage efficace (p. 44)>>. Nous
devons expérimenter la capacité des groupes humains à coopérer dans des systèmes complexes.
Cette coopération n’est pas le confinement ou le
cloisonnement d’hier. Elle doit intégrer les inévitables
conflits. Elle laisse à chacun le soin de se motiver, car la motivation est personnelle quand les mobiles sont
collectifs. Il faut plus de transparence, moins de
rétention d’informations , mais pas moins
d’organisation. Car <<supprimer les intermédiaires,
c’est bien sûr supprimer des situations de pouvoir. Mais ce
n’est pas du tout se débarrasser des problèmes de pouvoir.
C’est, en revanche, supprimer les protections qui permettent d’en
alléger le poids (p. 48)>>.
Auto-organisation:
contrairement au taylorisme, cette organisation
s’invente elle-même. Les entreprises deviennent des laboratoires.
Les équipes de travail deviennent des équipes de recherche en
organisation. La séparation entre chercheurs extérieurs,
consultants intermédiaires, services fonctionnels prescripteurs et
opérationnels exécutants n’est plus possible. Le laps de
temps serait trop grand entre la perception du problème et sa
résolution. Il faut une recherche appliquée à laquelle
les entreprises sont peu coutumières dans le domaine de
l’organisation: <<elles sont prisonnières des modes de
pensée engendrées par leur logique et leurs principes
d’organisation, qui les empêchent de conceptualiser cette
réalité qu’elles vivent (p. 49)>>.
L’entreprise préfère l’ activisme
préopératoire à la
réversibilité des opérations
réflexives. Or, <<les problèmes d’organisation sont
à la fois conceptuels et existentiels. Le vécu
précède l’idée, mais seule l’idée
permet de comprendre le vécu et donc de le formaliser,
de le développer et de reculer les limites du possible. Tant
qu’il n’y a pas de concept nouveau, le développement est
extrêmement lent. L’émergence d’un concept nouveau ne
peut se faire en revanche qu’à partir de l’
expérience (p. 49)>>. A l
’expérience physique , il faudra ajouter
l’ expérience logico-mathématique . Mais
sans la possibilité pour chacun de tenir une parole de
vérité à partir de son vécu, il n’y
aura pas d’expérience et encore moins de
capitalisation des expériences individuelles en une
expérience collective. C’est ce que montrent les conditions des
apprentissages individuel et organisationnel.
Cette nouvelle logique se caractérise par une ouverture
à la clientèle. Elle suppose aussi une vraie capacité de décision, à
tous les échelons et le plus près possible du client.
L’intégration, le conformisme et la routinisation étaient
un moyen de réduire les coûts de transaction. <<Mais
à notre époque, ce sont les coûts
d’intégration qui deviennent le point sensible. Ils
s’alourdissent en raison de l’incapacité des
systèmes de direction à s’adapter aux exigences de
liberté des agents et à la complexité des
problèmes à traiter. De sorte qu’il peut devenir plus
rationnel d’accepter des coûts de transaction plus
élevés. C’est un peu l’objectif des réseaux
de franchise et des entreprises conjointes (p. 60)>>. C’est ce
qu’expérimentent les organisations
virtuelles.
Castrée par la coupure taylorienne entre
décideurs et exécutants, l’entreprise développait
une séparation entre l’affectif et le cognitif. Nous avons
montré, par un retour au texte de Piaget,
que cette coupure est contre-productive. <<Ce qu’on cherchait
à atteindre, c’étaient les ressorts de cette
affectivité, pour l’orienter dans le sens du
bien commun défini par les spécialistes du rationnel. Dans la
vision qui commence à émerger, la rationalité ne sera
plus limitée aux ingénieurs ni l’affectivité aux
ouvriers: on va rechercher de plus en plus le mobile du comportement des
subordonnés dans le calcul rationnel, stratégique, qu’ils
peuvent faire. Le groupe ne sera plus considéré comme un groupe
de résistance ou de collaboration se déterminant en fonction de
son affectivité, mais comme une unité diversifiée dont
les membres cherchent à maximiser leurs avantages en fonction de la
logique du jeu dans lequel ils sont ensemble engagés, et dont ils vont
modifier les règles (p. 63)>>.
Le projet
d’entreprise est considéré comme un moyen de motiver le
personnel. C’est une erreur. La motivation n’est pas
exogène mais endogène. Le projet d’entreprise cherche
à promouvoir des valeurs éthiques comme la publicité fait
la promotion des produits de l’entreprise. <<Le risque,
c’est que, même si on réussit, il existe une distance
considérable entre les valeurs officielles, fussent-elles très
sincèrement professées, et les valeurs plus profondes qui
gouvernent réellement les comportements, de façon souvent
inconsciente (p. 65)>>. En termes freudiens: le discours latent est plus
prégnant que le discours manifeste. Car la publicité ne parle
pas du produit réel, mais fabrique une auréole autour de
celui-ci. Il en va de même pour la culture
d’entreprise , dans la communication institutionnelle.
<<La réflexion sur ce qu’est la culture d’une
entreprise est finalement la plus centrale intellectuellement et la plus
décisive dans la pratique. Mais cette réflexion n’a de
sens que si elle porte prioritairement non pas sur ce que devrait être
la bonne culture adaptée aux objectifs de l’entreprise, mais sur
la culture actuelle de l’entreprise telle qu’elle est
réellement, ici et maintenant (p. 66)>>. Il faut partir de
l’existant et non pas de la cible. Et pour cela, il faut regarder en
face les occasions de conflit. <<On croit trop facilement que le
consensus est un préalable pour assurer le
développement et la rénovation d’une organisation. Et on
cherche à le créer en travaillant sur les
motivations, c’est-à-dire l
’affectivité du personnel.
L’expérience montre pourtant qu’on obtient guère de
résultats convaincants quand on prêche des attitudes et des
valeurs consensuelles. Le consensus n’est pas un préalable
à l’action, mais au contraire le résultat d’une
action. Il s’élabore dans l’action (p. 67)>>.
![]() 2. La tentation du discours
2. La tentation du discours
Michel
Crozier constate une ambivalence des patrons français. Car leur
activisme est une façade. Il est une simplification de
la réalité, une dénégation de ses
contradictions. <<Mais l’analyse sociologique a depuis longtemps
montré que les contradictions constituent le tissu même de
l’action sociale courante. On ne peut comprendre la
réalité sociale et les chances de transformation et de
progrès si l’on n'accepte pas l’existence de contradictions
et si l’on refuse d’en analyser la signification (p. 70)>>.
Cette vision simpliste prépare des échecs, comme celui du
paternalisme. <<Le patron croit avoir la responsabilité,
c’est-à-dire le pouvoir et le droit, de façonner la
culture du groupe humain dont il a la charge (p. 72)>>. La
susceptibilité des Français est particulièrement vive en
cette matière. Les valeurs professées (la
cible) sont moins efficaces que les valeurs pratiquées
(l’existant). <<En fait, les valeurs
pratiquées dépendent du système de relations
humaines à l’intérieur duquel les gens agissent. Ce
système définit les règles du jeu, et tend à
récompenser certains comportements et à en pénaliser
d’autres selon la nature même du jeu qu’il a fait
émerger. Les attentes réciproques des divers partenaires le
renforcent, de sorte que tout effort pour agir différemment, soit
n’est pas perçu, soit est rejeté et
pénalisé. Les divers acteurs peuvent se plaindre, rêver
d’un autre jeu, ils restent prisonniers du jeu actuel (p. 74)>>.
Il faut toujours parler de l’existant et non pas de la cible.
L’abus du discours fait perdre, à tous, le
principe de réalité .
<<Déjà actuellement, les enquêtes le prouvent, les
rapports réels que les membres d’un ensemble managérial
entretiennent entre eux ne correspondent que très imparfaitement au
modèle idéal tel qu’il est représenté dans
l’organigramme officiel (p. 82)>>. Et, bien au-delà de
l’entreprise, <<c’est toute la société qui
doit s’ouvrir à des rapports humains plus flous, moins
cristallisés dans des positions stratifiées, qui doit accepter
de vivre dans un mouvement plus rapide, avec des rapports plus directs, en
tolérant une fluidité sociale plus grande, comportant aussi bien
descentes que montées dans l’échelle (p. 83)>>. La
crainte de toucher au statu quo bloque les transformations nécessaires.
Pourtant, <<toutes sortes d’indices nous montrent que les
individus sont beaucoup plus ouverts au changement
qu’on ne le croit, et généralement en avance sur leurs
institutions (p. 83)>>.
La
stratégie de communication de beaucoup de chefs d’entreprises est
particulièrement mal adaptée. Les cadres reprochent à la
direction de ne pas pratiquer les principes qu’elle essaye de vendre. Il
semblerait que l’image de la persuasion clandestine soit refusée
dans l’entreprise. Pourtant, un cadre qui trouve tel slogan publicitaire
valable pour le consommateur et tel mot d’ordre pertinent pour les
ouvriers, ne supporte pas qu’on l’applique à sa
catégorie sociale. <<Sont systématiquement hostiles aux
programmes de communication ceux qui estiment qu’ils en sont la cible.
Sont favorables, ou au moins compréhensifs, ceux qui peuvent se placer
du côté de l’émetteur et qui s’identifient
avec les communicateurs (p. 101)>>. C’est donc la relation de
sujet à objet qui est refusée par tous les niveaux de
l’échelle. Mais chacun la pratique avec l’inférieur
ou l’extérieur. Par contre, la stratégie de persuasion est
acceptée quand elle s’accompagne d’une marge de manoeuvre
et du choix des moyens les plus adaptés aux circonstances
réelles. Il y a donc bien une revendication d’
autonomie. Depuis 1989, cette revendication s’est
fortement accrue. Selon l’enquête Cadroscope de l’APEC, la
proportion des cadres très de leurs relations avec leurs
supérieurs hiérarchiques est tombée, entre 1995 et 1996,
de 33 à 28%. Même les petites entreprises sont touchées
par cette insatisfaction. Pour Chantal Cumunel, <<il est clair que la
relation des cadres avec leur entreprise se dégrade. Cette prise de
distance porte en elle un risque prononcé de rupture”.
Nous sommes persuadé que: <<le rapport entre le
discours et la pratique devient un des problèmes fondamentaux du
redéveloppement économique français (p. 87)>>. Les
discours régnants sont ceux de la publicité et du
volontarisme. Ils sont hérités de la technostructure. L’époque est à
une reprise en main par les actionnaires. Mais le conflit n’est pas
présenté comme tel. Il nous semble que Michel Crozier est
passé à coté d’un aspect de la
réalité. Les directions des entreprises où il menait son
enquête lui avaient parlé d’une résistance des
cadres au changement. Sa réponse est que: <<les cadres ont les
mêmes conceptions et aspirations que les patrons... Il n’y a
aucune opposition intellectuelle au changement ni attachement sentimental au
passé.... Le management participatif... Partout on exprime une
adhésion intellectuelle sans réserve, doublée souvent
d’un véritable engagement affectif.... De toute façon,
l’idée que le groupe des cadres est sur ce point conservateur et
fait opposition au libéralisme des patrons apparaît radicalement
fausse (pages 90 à 92)>>. C’est la réponse à
la question formelle. Il se pourrait que la réponse aux patrons soit
biaisée par leur question. <<Ce que l’on reproche
principalement aux patrons, c’est de ne pas pratiquer eux-mêmes le
management participatif; d’être trop activistes, trop
pressés, d’exiger des résultats concrets quantitatifs; et
de ne pas laisser à leurs cadres la liberté de mettre en oeuvre
le changement en fonction des contraintes et des opportunités que
ceux-ci sont seuls à pouvoir bien apprécier (p. 95)>>. Il
nous semble que ce même reproche peut s’appliquer à la
direction, aux cadres et aux exécutants, avec des
responsabilités bien différentes.
C’est aux
trois niveaux de conception de l’entreprise
qu’il y a loin entre les discours et les réalités. Michel
Crozier n’a peut-être pas attaché assez d’importance
à son propre constat: <<Souvent, il est vrai, on se trouve devant
des oppositions de castes, par exemple entre le groupe des cadres
supérieurs, qui communiquent avec le sommet, et le groupe des cadres
moyens qui, eux, sont tournés vers le bas et se plaignent de ne pas
être écoutés (p. 96)>>. Certes le terme de caste
n’est pas adapté. Il nous semble que l’entreprise toute
entière est prise dans un activisme contagieux et un discours de type
publicitaire. Partout, on refuse de voir la réalité dans sa
complexité. En tant que client, on tient un discours.
En tant que fournisseur, on pratique l’inverse. Cette
représentation simplificatrice du réel est
caractéristique de l’ activisme. Elle est une
régression au niveau
préopératoire , une nostalgie de l’action du
niveau sensori-moteur . Nous avons essayé de montrer,
avec le Graphe d'Exploration des Possibles, que les
niveaux politique (dirigeants), stratégique (cadres, fonctionnels) et
tactique (exécutants, opérationnels) ont développé
trois représentations de l’entreprise, à partir de leurs
propres expériences physiques . Mais, non
formalisées, ces trois
représentations ne peuvent pas communiquer entre
elles. Ce sont plus que des jargons
spécialisés. Ce sont des sémiotiques
divergentes. C’est pourquoi, face au spectacle
décisionnel qui perpétue la vision d’une
causalité
magico-phénoméniste, de nombreux chercheurs en
viennent à douter que l’entreprise prenne
de véritables décisions.
Car
l’expérience physique ne suffit pas à produire des
connaissances. Elle ne permet pas l’apprentissage organisationnel. Il lui manque
la formalisation des connaissances et la libre circulation des informations. Il faut
développer l’ expérience
logico-mathématique . Et nous sommes en phase avec Michel
Crozier: l’entreprise ne sait pas formaliser son propre vécu.
Pour sortir de l’activisme et de l’
économisme: <<beaucoup plus que
d’instruments de mesure ultra-précis, on a besoin
d’instruments différenciés permettant de s’adapter
à des situations qui peuvent être extrêmement
différentes (p. 108)>>. Plus que tout, les évaluations
individuelles doivent être distinguées des mesures de performance collectives.
![]() Conclusion
Conclusion
La tentation du discours
n’est pas nouvelle. Elle est probablement aux sources mêmes de
notre culture. Sous des formes multiples, et tout particulièrement dans la Chrétienté féodale
d’où à émergé le
marché puis le capitalisme, toutes les cultures ethniques affirment
que le Verbe se fait chair ou leur mépris
pour le travailleur en contact direct avec la matière
ou la nature externe . Ainsi faut-il considérer
sérieusement le le déficit de
connaissance que l’organisation réelle a sur elle-même.
Il nous semble, au contraire, que c’est en comblant ce déficit et
en relevant le défi de la connaissance que l’organisation, au
lieu de s’appuyer sur son institution, peut permettre
à l’individu de développer la percolation des
émotions ou le dialogue entre ses instances .
Quant à elle, l’organisation apprenante aura le souci
d’assurer la percolation des revenus par un dialogue véritable avec les utilisateurs qui ne
sont pas seulement des clients. Il n’est pas de dialogue interne sans
dialogue externe. C’est ainsi que l’organisation apprenante peut
sortir de la totalité pour une ouverture sur
la globalité .
![]() Auteur
Auteur
Créé le 28 Août 1997
Modifié le 20
Juin 1999
![]() Suite
Suite
![]() Bibliographie
Bibliographie
L’entreprise
à l’écoute
Apprendre le management
post-industriel
Michel Crozier
Seuil, 1994
Coopération et Conception
Gilbert
de Terssac, Erhard Friedberg (sous la direction de)
Collection Travail
Éditions Octarès
Toulouse, 1996
330 pages,
180 F
Commenté dans Coopération et Conception
![]() Définitions
Définitions
Les termes
en gras sont définis dans le glossaire
alphabétique du R.A.D.
![]() Retours
Retours
![]() Pour votre prochaine
visite
Pour votre prochaine
visite